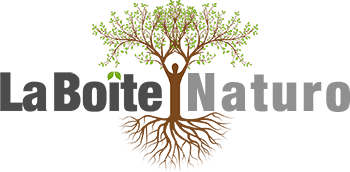Définition du fer dans le sang
Le fer est un constituant essentiel de l’hémoglobine, protéine présente dans les globules rouges et dont la principale fonction est de transporter l’oxygène dans l’organisme.
Il est également indispensable à d’autres fonctions de l’organisme, comme la synthèse de l’ADN ou certaines réactions enzymatiques.
Environ 70% du fer de l’organisme est lié à l’hémoglobine, tandis que le reste est fixé à des protéines de transport (la ferritine ou la transferrine) ou stocké dans certains tissus du corps. Par exemple, dans la moelle osseuse, le fer est stocké et il est utilisé si besoin pour fabriquer de nouveaux globules rouges.
Le fer provient de l’alimentation (le foie et autres viandes, les œufs, le poisson, ou encore les légumes verts). Il est particulièrement nécessaire pendant la croissance, la grossesse, l’allaitement ou encore après un important saignement.
Pourquoi faire une analyse du taux de fer ?
Le dosage permet d’évaluer le taux de fer dans l’organisme et la manière dont il est métabolisé (c’est à dire assimilé par l’organisme). Cela permet au médecin de diagnostiquer par exemple une carence martiale (carence en fer), une anémie ferriprive (anémie due à une carence en fer), une hémochromatose (excès de fer dans l’organisme), mais aussi de vérifier l’état nutritionnel du patient.
Attention : le dosage de la ferritine est souvent effectué en premier lieu, le dosage du fer seul étant rarement indiqué (il peut l’être avec le dosage de la transferrine en seconde intention).
Le déroulement de l'analyse du fer
L’examen de référence pour estimer la quantité de fer dans l’organisme est l’examen de la moelle osseuse, à partir de l'aspiration ou de la biopsie de moelle osseuse. C’est un examen invasif et traumatique qui n’est donc pas pratiqué en routine.
Le dosage du fer sérique (dans le sang) peut s’effectuer par un prélèvement de sang veineux, réalisé généralement au niveau du pli du coude. Il est rarement effectué seul, car il a peu d’intérêt diagnostique. Le plus souvent, il est associé à d’autres dosages tels celui de la transferrine sérique, et parfois celui de la ferritine sérique, des récepteurs solubles de la transferrine ou de la ferritine intra-érythrocytaire.
Le taux de fer étant plus élevé le matin, l’examen se déroule de préférence à cette période de la journée.
Quels résultats peut-on attendre d'une analyse du fer ?
Le taux de fer dans le sang est normalement compris entre 70 et 175 μg/dl (microgrammes par décilitre) chez les hommes et entre 50 et 150 μg/dl chez les femmes mais il varie énormément chez une même personne au cours de la journée (amplitude de 30 à 40 %). C’est pourquoi, il est important d’y associer le dosage de la transferrine et le calcul du coefficient de saturation de la transferrine.
Un taux élevé de fer sérique peut-être le signe, entre autres, de :
- une hémochromatose (surcharge en fer)
- une anémie hémolytique (destruction prématurée des globules rouges dans le sang)
- une nécrose hépatique
- une hépatite (inflammation du foie)
- une cirrhose
- l’alcoolisme chronique
- la répétition de transfusions sanguines
Au contraire, un niveau bas de fer peut être lié à :
- une perte de sang importante, notamment lors de menstruations abondantes
- une grossesse
- une carence en fer (carence martiale) liée à l’alimentation
- une carence liée à une incapacité à absorber correctement le fer
- des saignements dans le tractus intestinal (des ulcères, un cancer du côlon, des hémorroïdes)
mais aussi une inflammation, une infection, après une chirurgie, etc.
Encore une fois, notons que ce dosage effectué isolément n’a pas d’intérêt médical.