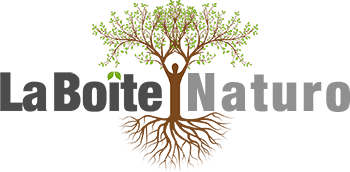Définition de la bilirubine
La bilirubine est un pigment non soluble dans l’eau de couleur jaune, issu de la dégradation de l’hémoglobine. Elle est le principal colorant de la bile. Elle est produite dans les cellules de la rate et de la moelle osseuse, et est ensuite transportée dans la circulation sanguine par l’albumine pour rejoindre le foie. Une fois présente dans le foie, elle est conjuguée à l’acide gluconique et devient soluble dans l’eau. Dans les intestins, la bilirubine conjuguée donne la couleur brune aux selles.
Pourquoi faire une analyse de la bilirubine ?
Le médecin prescrit une analyse sanguine la bilirubine s’il suspecte par exemple :
- des affections hépatobiliaires : affections qui touchent le foie (l’hépatite étant la plus fréquente) et/ou les voies biliaires
- des syndromes hémolytiques (caractérisés par une destruction anormale des globules rouges)
- ou encore un ictère du nouveau-né, appelé aussi jaunisse du nouveau-né
L’examen de la bilirubine
Pour une analyse de la bilirubine, il faut pratiquer un examen sanguin qui consiste en une prise de sang veineux. Il est recommandé de ne pas boire ni manger au moins 4 heures avant la prise de sang. Le médecin peut également demander au patient d’arrêter de prendre certains médicaments pouvant affecter les résultats du test de bilirubine.
Quels résultats peut-on attendre d'une analyse de la bilirubine ?
La quantité de bilirubine totale dans le sang est normalement comprise entre 0,3 et 1,9 mg/dl (milligrammes par décilitre). La quantité de bilirubine conjuguée (appelée aussi bilirubine directe) est normalement comprise entre 0 et 0,3 mg/dl.
Notons que les valeurs dites normales de bilirubine dans le sang peuvent varier selon le laboratoire qui effectue les analyses.
Seul un médecin pourra interpréter les résultats et vous donner un diagnostic.
Si le taux de bilirubine est élevé, on parle d’hyperbilirubinémie.
Il peut s’agir d’une :
- prédominance de la forme libre (par excès de production ou un défaut de conjugaison) :
– accidents transfusionnels
– anémies hémolytiques : hémolyses toxiques, médicamenteuses, parasitaires, etc.
– maladie de Gilbert (anomalie génétique du métabolisme de la bilirubine)
– ictère du nouveau-né
– syndrome de Criggler-Najjar (trouble héréditaire du métabolisme de la bilirubine)
- prédominance de la forme conjuguée (la bilirubine conjuguée est libérée dans la circulation lorsque la voie normale d'excrétion est bloquée):
– calcul biliaire
– néoplasie (cancer)
– pancréatite
– hépatite toxique, hépatite alcoolique, hépatite virale
– cirrhose
On distingue notamment les "ictères à bilirubine libre", qui sont plutôt dus à un excès de destruction des globules rouges (hémolyse) des "ictères à bilirubine conjuguée", plutôt liés à une maladie biliaire ou hépatique.